
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30395
En 2009, est paru (Presses universitaires du Québec) le livre du sociologue canadien Amnon Jacob Suissa, Le monde des AA, Alcooliques, gamblers, narcomanes. Dans cet article, je me propose de commenter seulement quelques points - qui me semblent essentiels au regard de la philosophie des fraternités – mis en évidence dans ce livre par ailleurs très complet et très bien documenté. D’un côté, l’étude de AJS permet en effet de retracer dans le détail la genèse historique des groupes, et abonde en distinctions sociologiques très fines sur les divers postulats, comportements, traditions, etc. des fraternités. C’est ainsi d’ailleurs que je relève rapidement deux anecdotes significatives sur ces groupes dans la première partie de son livre (et de mon article).
D’une façon générale, le livre d’AJS est assez critique concernant ce qu’il appelle « l’idéologie des AA », avec quelques passages toutefois sur les points forts de ce mouvement. En un sens, je pourrais dire que ce livre est – symétriquement - l’exact opposé du mien. Il faut dire à cet égard que sa provenance n’est sans doute pas sans incidence sur cette différence : l’idéologie AA étant très prégnante, voire hégémonique, sur le continent Nord américain, l’auteur cherche des alternatives à ces méthodes - il en décrit d’ailleurs quelques unes dans sa dernière partie. A l’opposé, les fraternités ont chez nous un statut de minorité pour laquelle je m’efforce d’obtenir une forme de reconnaissance ; et cela dans la mesure où, dans une perspective de philosophie sociale, je travaille au déploiement de la logique interne d’une pensée, (Texte 1. Livre sur les groupes d'entraide ) d’une éthique et d’une méthodologie visant à émanciper des individus de phénomènes de dépendance.
Une critique revient de façon récurrente dans ce livre, et intègre ou subsume en quelque sorte une constellation de critiques plus périphériques : la médicalisation de la société que ces groupes sont censés alimenter selon cet auteur, avec ses conséquences éthico politiques. N’étant pas convaincu par la démonstration d’AJS, je m’efforce de montrer en quoi elle comporte un certain nombre de contradictions. D’autre part, au-delà de l’ouvrage particulier d’AJS, ce livre fait apparaître à mon sens les limites de l’approche sociologique pour ce type de sujets, limites qui apparaissent clairement en ce qui concerne notamment le traitement quasi inexistant de la dimension spirituelle des groupes et de ses implications thérapeutiques.

Comme sans doute de nombreuses études sur la question des groupes émanant du territoire nord américain, le livre d’AJS est précis, riche en informations de toute nature. Ce travail socio historique permet ainsi d’apprendre beaucoup de choses, pas forcément connues du public français. Notamment le fait que Bill Wilson, le fondateur de AA, a expérimenté le LSD en 1956 en Californie, expérience supervisée par des psychiatres. Expérience assez décisive pour lui, comme pour d’autres, en ce que le LSD aurait participé d’un retrait de ses barrières mentales, lesquelles empêchent normalement un accès à une conscience d’ordre cosmique. Bill aurait donc considéré qu’il s’était agi là d’une véritable expérience spirituelle, féconde en l’occurrence pour le traitement de son alcoolisme. Anecdote qui, personnellement, tendrait à me rendre le personnage plutôt sympathique dans la mesure où elle révèle une facette inconnue de sa personnalité, et qu’elle l’inscrit dans une tradition américaine de la contre culture – au même titre que le psychiatre californien T. Leary, connu également pour ses expérimentations avec le LSD, ou encore l’ethnologue Carlos Castenada et ses études sur les chamanes, voire la route de Kérouac, ou encore le flower power – que j’ai appréciée en son temps. Quoi qu’il en soit, ce versant de l’histoire de Bill permet de remettre en question l’image austère de protestant congrégationaliste que l’on imagine couramment, et plus loin, la réputation d’ayatollah de l’abstinence traditionnellement attachée à ces groupes d’entraide.
La seconde anecdote, beaucoup moins sympathique, concerne la référence à Himmler : pour le dire vite, en 1936, Bill a continué à entretenir des relations avec Buchman, le leader du groupe religieux Oxford, prêcheur de l’abstinence, mais aussi largement compromis avec divers fascistes éminents, proche de Himmler, et qui pensait surtout que les problèmes sociaux ne pouvaient être globalement résolus que par l’intermédiaire d’une théocratie. On peut interpréter cette attitude, certes fortement contestable, comme une observation radicale de la priorité de la recouvrance sur toute autre considération, et surtout comme une mise en pratique scrupuleuse de la 10ème tradition stipulant que les groupes n’ont pas d’avis sur les sujets extérieurs.
Il va de soi cependant qu’est ainsi posé le problème des limites d’une telle attitude, et celui, redoutable (que j’évoque plus loin), de la rencontre entre le programme et une idéologie politique. Cette rencontre alimente t-elle cette idéologie ? Sur un plan éthique, quel positionnement convient-il d’adopter en la circonstance ? Peut-on toujours se contenter d’un repli sur les traditions ?

Plus fondamentalement, la critique récurrente d’AJS concerne la médicalisation de la société que ces groupes seraient censés alimenter, médicalisation dont les tenants et aboutissants éthico politiques dépassent bien entendu la question des fraternités et de leur idéologie particulière. Par souci de concision, je ne ferai pas de citation du livre d’AJS ; mais, si la démonstration est assez convaincante sur ce plan plus général, elle me semble toucher moins juste en ce qui concerne les fraternités.
Tout d’abord, en matière d’addictions, il me semble que les concepts scientifiques sont « toujours déjà » teintés d’idéologie politique[i]. A cet égard, je remarque que l’analogie avec le diabète, comme figure emblématique de la maladie chronique (qui proviendrait des groupes à l’origine, m’a-t-on dit) ne pose pas vraiment problème quand il s’agit de justifier un éventuel traitement de substitution ad eternam. Autrement dit, quand cette métaphore permet de justifier une politique de substitution, ou encore d’alimenter le registre conceptuel de cliniques dispensant des traitements de substitution très onéreux, elle est acceptée sans réel souci. Etrangement, cette référence devient absurde, non scientifique, et comme relevant d’une orthodoxie désastreuse lorsqu’elle émane des groupes.
En outre, peut-on, sans contradiction, à la fois reprocher aux groupes cette tendance à la médicalisation, et leur en vouloir de considérer que le salut ne peut venir que d’un abandon de l’espoir en la médecine ?
Si les rapports sont tendus depuis le départ avec les médecins, c’est bien en raison de cette tendance – désormais beaucoup moins radicale – des fraternités à considérer que la solution de leur problème passait par un abandon de tout espoir d’ordre médical. Abandon considéré comme essentiel dans la reddition qui fait partie intégrante du processus spirituel de conversion et de recouvrance. Sans entrer ici dans le détail, la correspondance entre Jung, le psychanalyste zurichois, et Bill est à cet égard tout à fait explicite.
Il me semble nécessaire toutefois de clarifier un peu cette question de la maladie. A ce sujet, je me permets de citer mon chap. 2 :
« Dans un cadre strictement scientifique, on ne peut, pour le moment, repérer des marqueurs biologiques précis de la dépendance. De fait, des expériences en laboratoire (avec des singes[ii]) montrent qu’il est possible de repérer des terrains génétiques de vulnérabilité, mais en aucun cas un gène particulier de la dépendance qui impliquerait un destin inéluctable. Avec ce type de phénomènes, on ne se situe pas dans le cadre d’une maladie mono génique ; et, dans ce cas de figure, le paradigme mendélien fournit une grille d’intelligibilité insuffisante. De toute façon, l’expression phénotypique d’un génotype reste aléatoire. Pour que s’actualisent effectivement à chaque moment du développement individuel des comportements récurrents de compulsion, les gènes de vulnérabilité en question ont besoin d’être corrélés avec tellement d’autres facteurs environnementaux qu’il est assez dérisoire de chercher une vérité sur cette problématique dans la génétique, du moins en l’état actuel des recherches. »
Dès lors, les membres des groupes, dont certains sont parfaitement au fait des avancées de la science, utilisent le terme « maladie » de façon métaphorique. AJS tend à minorer cette distinction, considérant que cela ne change pas grand-chose sur le fond, et que ce statut de malade constitue quoi qu’il en soit une définition réductrice de l’identité. Cette critique touche sans doute juste à divers égards, mais mériterait un approfondissement (qui ne fait pas l’objet de cet article). Plutôt que métaphorique, je parlerais plutôt pour ma part d’approche pragmatique, le concept ayant diverses fonctions de techniques thérapeutiques, éthiques, voire politiques (je me cite là aussi – chap. 2)
« Il est donc probable que, pour beaucoup d’entre eux, cet énoncé n’ait pas valeur de vérité scientifique. Autrement dit, il s’agirait moins à leurs yeux d’un énoncé théorique que d’un énoncé pragmatique. Il convient là aussi de revenir à l’origine ; la simple reconnaissance du statut d’alcoolique est déjà un pas vers la guérison. Comme l’écrit James dans son Précis de psychologie, « L’effort que fera l’alcoolique pour donner le nom d’ivrognerie à son acte ne sera pas loin de le guérir »[iii]. C’est paradoxalement l’idée de la reconnaissance d’une impuissance, et a contrario de l’absence de possibilités de contrôle sur la consommation, qui est ici recherchée (V, 2, §c).
D’autre part, chez le Dr Silkworth lui-même, la conceptualisation de l’alcoolisme comme maladie a eu - aussi - pour but de mettre un terme à la stigmatisation morale et religieuse dont ces personnes étaient l’objet. D’une certaine manière, le concept de dépendance a encore cette vertu aujourd’hui, en ce qu’il permet de dépasser la distinction concernant l’aspect licite ou non des produits, et de mettre fin par là même à la stigmatisation des toxicomanes ainsi qu’à l’hypocrisie concernant l’alcoolisme ».
Au-delà de l’aspect épistémologique, pour AJS, le concept de « maladie » serait, sur le plan éthique, une façon de s’exonérer de sa responsabilité. Sur ce point, il me semble que - essentiellement cette fois - la critique passe à côté (je me cite encore, ibidem) :
« Il ne s’agit pas pour autant de compassion larmoyante envers les dépendants, ou encore de déresponsabilisation. Dans la philosophie des fraternités, l’assimilation à une maladie implique que ces personnes ne sont pas responsables de leur maladie certes, mais qu’ils le sont des actes à mettre en œuvre pour se rétablir. »
Je souligne, parce que cet aspect de la philosophie des AA, lié au « juste pour aujourd’hui », est essentiel, et non pas un élément secondaire de la méthode. Mais surtout, là aussi, la critique est contradictoire. On ne peut en effet à la fois reprocher aux membres de se focaliser sur la maladie et d’esquiver ainsi leur responsabilité, et en même temps leur reprocher – toujours en raison de ce privilège accordé à l’idée de maladie - de ne pas prendre en considération les déterminations sociologiques qui entraînent les phénomènes de dépendance, comme le laisse entendre AJS.
On ne peut donc parler de déresponsabilisation : au contraire, les membres des groupes tendent à considérer que c’est une chose d’analyser, de prendre en compte de l’extérieur, du point de vue du savant, un certain nombre de dimensions sociopolitiques au principe de l’exclusion et des conduites de consommation excessive ; cela en est une autre d’aborder la question de l’intérieur, du point de vue du sujet en situation d’aliénation, et qui cherche à entrer dans un processus de recouvrance. Que les sociologues, les philosophes, les psychologues, les addictologues, les travailleurs sociaux, voire les médecins ou même les politiques se questionnent sur les conditions socio historiques d’une consommation pathologique exponentielle, qu’ils mettent en œuvre ou préconisent des mesures socio thérapeutiques, médicales ou policières à cet égard est certes une nécessité. Mais, du point de vue de celui qui ne parvient pas à modifier des comportements source de souffrance pour lui et son entourage, peu lui chault de savoir que sa conduite est en partie conditionnée socialement ; d’un point de vue pragmatique, nous (les professionnels) sommes assez bien placés pour savoir que ce type de considérations tend même à jouer comme un mécanisme de défocalisation, voire une fuite dans l’intellect, une stratégie d’évitement quoi qu’il en soit des dispositions à prendre pour recouvrer la santé.
Une approche pragmatique de cette problématique permet au contraire d’aborder les faits de façon plus responsable (je cite toujours mon chap. 2) :
« Le docteur Silkworth (premier médecin favorable aux groupes) parle d’allergie, ce qui est plus que contestable scientifiquement ; reste que nous faisons tous le constat banal que nous sommes inégaux devant les produits ; quoi qu’en disent les défenseurs de la gestion expérientielle, par exemple, qui entendent déplacer la problématique de la dépendance vers une gestion intelligente du plaisir, il est évident que certaines personnes ne peuvent se permettre de boire, ne serait-ce qu’un verre d’alcool, sans entraîner une rechute totale avec son cortège de conséquences désastreuses[iv]. Il est peu probable que ce soit là une question d’éducation, ou de gestion, cette dernière idée fonctionnant plutôt comme un leurre pour les personnes dépendantes – leurre tendant à alimenter la rhétorique déjà « féconde » du déni. On peut certes dans cet ordre d’idée reprocher à l’idée de nécessité d’abstinence totale sa fermeture, au sens où elle exclue la possibilité d’une « rémission partielle » qui est sans doute possible pour certains individus ; mais, nous doutons qu’ils soient numériquement majoritaires ».
Loin d’exonérer le patient de sa responsabilité, les groupes au contraire la sollicitent, dans le processus thérapeutique, et en termes de construction d’eux-mêmes. C’est même, paradoxalement, sans doute un point problématique sur un plan plus politique. Cette question rejoint en effet de façon détournée la critique plus globale d’AJS – laquelle correspond aussi à celle de R. Gori, par exemple, concernant la médicalisation actuelle de la société. Ne pourrait-on dire en effet, que, dans un contexte aggravé par la crise que nous connaissons, l’idéologie des 12 étapes devient l’alliée objective du libéralisme, au sens où elle rencontre ainsi une volonté politique de désengagement de l’Etat dans les secteurs médico sociaux, éducatifs, etc. ?
C’est sans doute un point essentiel, où rien n’est écrit à mon sens, mais où l’on atteint peut-être les limites de l’attitude de neutralité que je décrivais plus haut dans un contexte plus tragique. Quoi qu’il en soit, une question se pose effectivement : les groupes peuvent-ils être considérés comme les promoteurs d’une alter thérapie, avec la dimension de don contre don et de transmission qu’elle implique, ou sont-ils plus prosaïquement l’expression, l’un des nombreux symptômes de l’idéologie libérale qui entraîne vers toujours plus de désengagement et d’hyper individualisme ?
Rien n’est écrit à cet égard, encore une fois, et il leur appartiendra en quelque sorte de se positionner ou non à cet égard; mais je vois mal, là aussi, que l’on puisse sans contradiction reprocher à la fois cette tendance individualiste aux membres des groupes et leur supposée aliénation communautaire. A mon sens, de par leur insistance sur la sobriété (Texte 3. Joie de la sobriété ), leur parcours spirituel et moral et leurs dimensions d’entraide, ils peuvent être considérés comme l’une de ces micro résistances à ce que Raphaël Simone appelle le « monstre doux », cet état de la société actuel qui incarne les prévisions de Tocqueville, et dans lequel nous sommes conduits de façon somnambulique à toujours plus de jouissance, de consommation et d’individualisme.
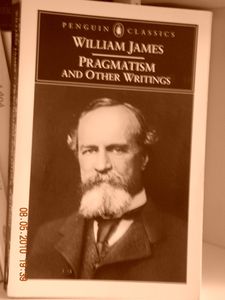
Un autre aspect qui pose problème à mon sens, au-delà du livre particulier d’AJS, est la limite d’une approche sociologique, ou même médicale, pour ce qui concerne la logique interne des fraternités, et notamment leurs dimensions spirituelles. Limites qui vont de pair avec une définition assez faible du pragmatisme, dont on ne voit pas clairement qu’il s’origine en grande partie dans un contexte de débat houleux avec le scientisme du 19ème siècle.
Est-ce dû à sa formation de sociologue, ou à d’autres déterminations ? Toujours est-il qu’AJS s’attache à minorer la distinction opérée par les groupes entre religion et spiritualité ; sa forte insistance sur la filiation des fraternités avec les groupes Oxford dont le dogme était clairement déterminé, s’inscrit dans cette logique, comme s’il fallait absolument mettre en avant la dimension confessionnelle, peut-être fermée, et aussi non scientifique de ces groupes. Cette façon d’appréhender le problème revient à minorer le pouvoir de quelque chose de bien différent, ce qu’il convient de considérer comme une énergie à même de bouleverser aussi bien la trajectoire d’un individu que les catégories d’analyse classiques. En minorant la distinction, on tend à mentionner l’aspect spirituel des groupes comme s’il s’agissait d’une qualité, d’une caractéristique parmi d’autres – comme un certain comportementalisme, ou encore le privilège de l’abstinence. Mais on ferme alors les yeux sur le fait que cette dimension spirituelle change complètement la donne en ce que foi et confiance peuvent permettre de réorienter la vie d’un sujet. D’une part, cette énergie spirituelle tend à bouleverser entièrement la vie d’un homme ; mais, dès lors, elle transcende aussi toutes les autres caractéristiques et articulations de ce qu’il faut persister malgré tout à appeler une méthode thérapeutique, et qui, vue de l’extérieur, peut sembler « étrange », exotique, etc.
La référence à William James, philosophe empiriste, pragmatiste, psychologue, au fait des problèmes de dépendance, et dont on trouve mention vers la fin du Gros livre, permet de comprendre cette distinction, et surtout ses implications (je cite mon chap. 4) :
Précisons qu’en cette fin du 19ème siècle dominée par le scientisme, dans l’esprit d’un certain nombre de penseurs, l’énergie religieuse, conçue sous sa forme pure en quelque sorte – c’est à dire détachée de tout dogme - fournit un surcroît de sens et de vitalité pour une civilisation tentée par un certain nihilisme. Dans ce contexte, il faut la concevoir comme un vecteur permettant de se redonner la force de croire, « la volonté de croire ». Comme l’écrit D. Lapoujade (2008), « Sous le pragmatisme classique des actes de langage où chacun doit se montrer à la fois pertinent, performant et compétent, se joue autre chose. C’est le profond vitalisme des frères James. Certaines vies sont portées par leur « foi », une foi d’autant plus intense que toute leur vie y est suspendue. »
Ainsi, pour James, - et je crois que c’est important ici -, l’énergie dite religieuse n’a pas été donnée aux hommes pour créer des dogmes, mais pour nous permettre de vivre. A cet égard, la référence à une puissance supérieure, à un dieu tel que chacun le conçoit, permet d’opérer la distinction, et s’inscrit dans la lignés des études jamesiennes.
La seule étude moderne, réellement sérieuse d’un penseur d’envergure sur les AA est celle de Bateson à ma connaissance (mais il existe toute une tradition de travaux en psychologie aux USA qui s’attachent aux effets de la spiritualité dans le traitement des addictions), laquelle permet de bien comprendre, en le systématisant, le mécanisme de conversion par lequel un homme touche le fond pour renaître à une seconde vie, plus riche, et plus attentive à l’autre. La référence à cet auteur est un peu limitée chez AJS, compte tenu de son importance dans l’explicitation de la méthode ; en outre, je ne suis pas sûr qu’il n’y ait pas incompréhension de sa part, notamment sur les concepts de symétrie et de complémentarité.
Dans cet ordre d’idées, le traitement par AJS du « juste pour aujourd’hui » est aussi limité. Il insiste notamment sur le fait que cela peut devenir une injonction à cesser de réfléchir et à rentrer dans le rang pour ceux qui se posent des questions sur la méthode. C’est passer sous silence toute la dimension clairement stoïcienne de cette formule, qui invite à se concentrer sur le moment présent afin d’en extraire une force de vie et de recréation de soi. Je crois d’ailleurs qu’il est faux de dire que l’idéologie des AA consiste en une abstinence à vie. Ce serait une pensée parfaitement contre productive, désespérante, et tournée vers l’avenir. Par contre, de façon stoïcienne, juste pour aujourd’hui… Là aussi je cite mon chap. 1 :
« …une des idées cardinales des fraternités consiste à se concentrer – plus même, à s’enraciner - dans le présent. Dans le cadre thérapeutique des fraternités, il s’agit d’exercer concrètement sa vigilance sur le moment présent à des fins de reconstruction de soi. Nous dirions que le problème consiste à réhabiliter le présent comme occasion de poser un acte recréateur de soi. Contre l’usure d’un combat qui s’avère long et difficile, tout l’art consiste à saisir la fine pointe de ce présent pour s’en servir comme d’une amorce de liberté. C’est le sens du concept - ou leitmotiv – des groupes « juste pour aujourd’hui » : cette posture vise à éviter de se perdre en conjectures, en inquiétudes sur le futur. Attitude qui se veut d’abord tactique et que l’on peut décrire de façon négative : pour le dépendant en soins l’avenir tend à se donner sous la forme d’un idéal d’abstinence et de bien être (même si c’est en partie illusoire). Par rapport à cet idéal, il compare inévitablement la situation présente et la juge négativement. Inversement, la vision de cet avenir peut aussi présenter un caractère insatisfaisant, désespérant de platitude. Quant au sens opposé - celui du passé -, il tend à générer de la nostalgie. A moins que ce passé ne soit au contraire source de remords et de culpabilité ».

La dernière partie du livre de AJS consiste à interpréter les résultats d’enquêtes sur les groupes, d’une part, et à décrire différentes alternatives à AA. Je ne peux que me féliciter de cette approche. Je me suis suffisamment élevé moi-même, aussi bien dans mes recherches philosophiques que dans le cadre de mon travail d’intervenant, contre l’absence de pluralisme et contre les approches hégémoniques, pour ne pas me mettre en position de défendre une méthode unique. Je crois d’ailleurs que cette volonté d’ouverture est aussi une partie du chemin que les groupes ont fait depuis une vingtaine d’années (et qui leur reste à faire). L’expérience me montre tous les jours que, de toute évidence, cette méthode convient à certains, et peut être contre productive, voire infernale pour d’autres.
Quant aux autres approches décrites par AJS, le temps et l’expérience feront leur œuvre et jugeront de leur fécondité.

[i] La définition-circonscription des concepts elle-même n’est pas « innocente », et relève d’enjeux idéologiques dont nous n’avons pas forcément conscience. Ainsi, par exemple, le fait de subsumer les fraternités et d’autres groupes (comme ASUD ou d’autres groupes de RDR) sous l’unité d’un concept - les « groupes d’entraide » - n’est pas scientifique. C’est une décision dont les ressorts sont enfouis dans notre histoire, psy, émotionnelle, etc. A mon sens, quoi qu’il en soit, c’est encore une manière – sans doute inconsciente – de se détourner des groupes, en déniant leur spécificité, une manière de refuser de mettre en évidence leurs dimensions spirituelles, etc., et surtout de laisser se déployer leur potentiel.
[ii] Voir notamment les travaux du neurobiologiste Philippe Gorwood. Nous renvoyons également au livre du Dr Batel (2008) p. 45 – 47, pour ce qui concerne l’héritabilité des troubles de l’alcoolisation. Globalement, l’auteur parvient à nos conclusions concernant l’apport – positif, mais limité et à utiliser avec parcimonie - de la génétique dans notre domaine d’activités.
[iii] Dans le même ordre d’idées, mais de façon plus pointue techniquement, puisqu’il s’appuie sur la cybernétique, Bateson postule que le problème du traitement de l’alcoolique est de parvenir à remettre en question ce qu’il appelle « l’épistémologie » commune Occidentale – en gros le dualisme cartésien qui oppose un soi volontaire à la bouteille en l’occurrence – qui ne lui convient pas. L’auteur écrit : «Le but poursuivi est de parvenir à ce que l’alcoolique place son alcoolisme à l’intérieur du « soi », ce qui ressemble fortement à la façon dont l’analyste jungien tente d’amener son patient à découvrir son « type psychologique » et à apprendre à vivre avec la force et la faiblesse qui lui sont caractéristiques. A l’opposé de cela, la structure contextuelle de la « fierté » alcoolique place l’alcoolisme en dehors du soi : « je peux m’empêcher de boire » » (Bateson, 1977, p. 279). Nous développons ce point plus précisément en V, 2, § c.
[iv] A cet égard la gestion expérientielle canadienne d’A. Therrien, relayée en France par le Dr A. Morel, nous semble très intéressante, mais uniquement sur le plan de la prévention.





