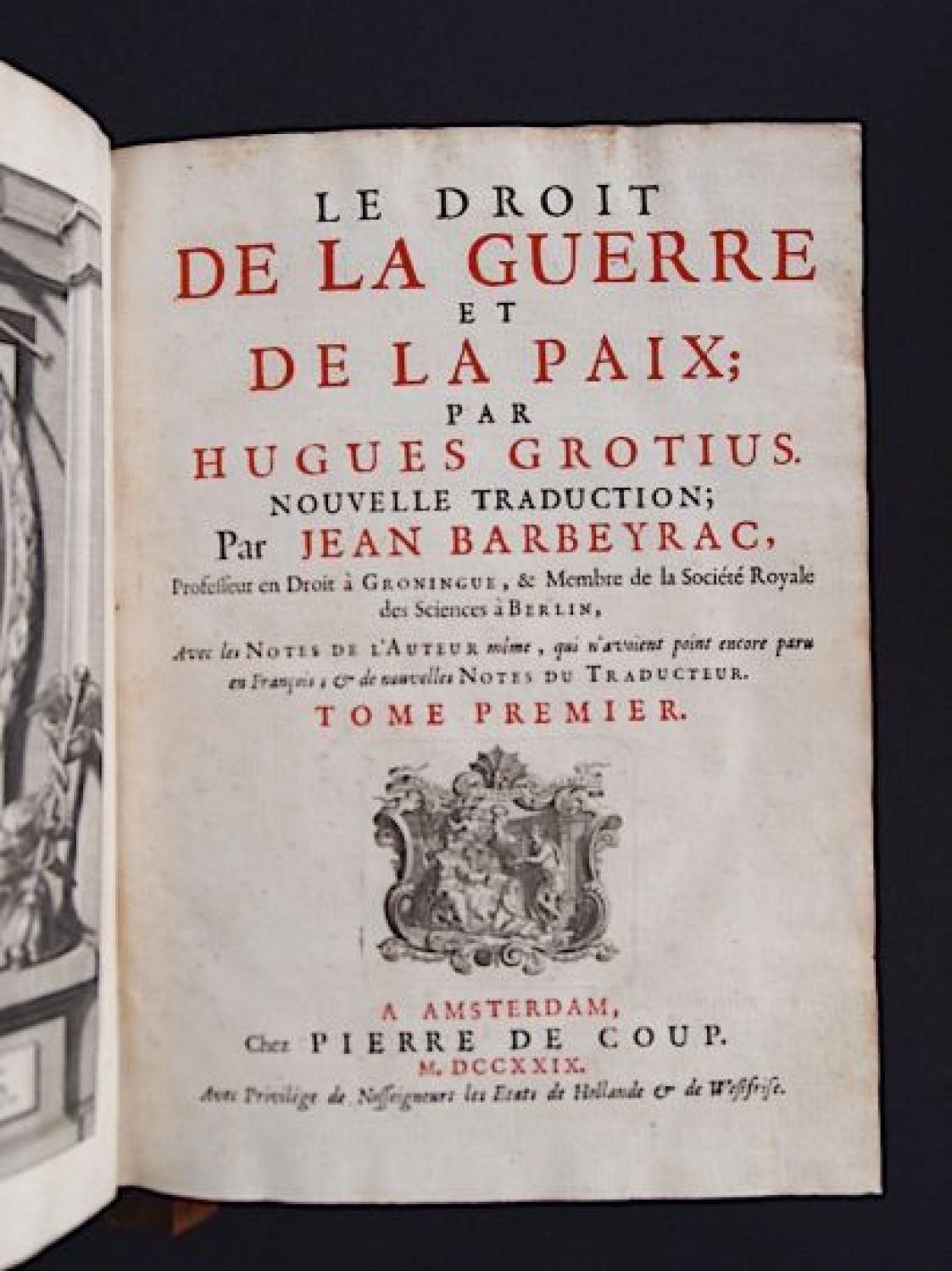"Caminante, no hay camino ; se hace camino al andar" (Pour le marcheur, il n'y a pas de chemin ; le chemin se fraye dans le cheminement") (A. Machado)

De toute évidence, la marche - ce geste simple et si profondément humain - possède un pouvoir régénérateur. Mais cette sensation, qui peut aller du simple mieux-être jusqu'à ce que j'appelle une expérience-source d'évolution existentielle, est soumise à certaines conditions. Des recherches scientifiques anglaises (université de British Columbia) et américaines (une récente étude publiée dans les comptes rendus de l’Académie américaine des sciences) montrent ainsi que les randonnées réduisent le stress, l’anxiété, boostent la confiance en soi, et libèrent de l’endorphine. Plus précisément, des études indiquent que des personnes ayant marché pendant au moins 90 minutes dans un milieu naturel présentaient moins de pensées négatives et une activité neuronale réduite dans le cortex préfrontal (zone du cerveau relative aux maladies mentales). Par contre, en milieu urbain, on ne repère pas de tels effets, la marche pouvant même alimenter des formes de mélancolie.
Alors que nombre d'entre nous souffrent aujourd'hui d'une dispersion chronique, d'une impossibilité à se concentrer, il est notable que la marche de randonnée fait partie de ces pratiques minimalistes qui, tel l'art du haïku des moines errants japonais (que je décris dans un article précédent), permettent de se délester à la manière d'un vagabond céleste pour aller vers la saisie d'une intensité, d'une tonalité affective.
Dans un monde régi par la rivalité mimétique, où mal-être, angoisse du vide et frustrations nous conduisent à trouver toujours plus de satisfactions dans l'accumulation (biens matériels, honneurs, etc.), où le désir se mue en répétition compulsive de toute sorte de comportements addictifs, la marche participe d'un dégonflage du moi et nous reconduit à une salutaire simplicité. Elle permet, naturellement et joyeusement, un recentrage, une reconnexion avec ce qu'il y a de plus profond et de plus lumineux en nous.
Pour l'aborder d'un point de vue plus philosophique, on pourrait parler de la marche comme vecteur phénoménologique. Et cela en ce sens qu'elle permet de "revenir aux choses mêmes", comme le disait Husserl. Certes, il ne s'agit pas de revenir aux choses communes et objectives de la quotidienneté ordinaire, que nous n'avons jamais vraiment quittées. Cependant, la marche permet de se délester de l'inessentiel, de relativiser notre attachement à des choses finies, qu'il s'agisse de possessions matérielles, d'avantages ou de positions sociales. Elle amène ainsi progressivement à se défaire d’un certain nombre de contraintes sociales ; et notamment la plus puissante (bien qu'illusoire) d'entre elles : l’identité. Quand on marche, avant tout statut social, ethnique ou religieux, on est d’abord marcheur ou pèlerin !
Ce moment de délestage comporte son envers puisque la marche conduit à une forme de rencontre nuptiale avec la nature. Revenir aux choses mêmes, c'est être reconduit vers ce que Merleau-Ponty appelle "la chair du monde", c'est devenir plus sensibles aux dimensions telluriques de notre rapport au monde et aux rythmes cosmiques de l'univers.
La marche, comme la poésie, éveille et sollicite à cet égard la présence, une pleine sensorialité. Joie et souffrances se confondent dans un rapport primitif et direct à la nature environnante - un rapport d'abord affectif. Le paysage, en marchant, se révèle toujours à nous progressivement ; et il nous imprègne de façon toujours singulière. Nous ressentons d’ailleurs différemment ce paysage en fonction de nos variations d’humeur. On peut ainsi parler d’une appropriation progressive, sensuelle et phénoménologique d'un paysage, et d'un chemin qui se révèle alors en tant que tel dans une majestueuse épiphanie.
Les vers de Antonio Machado cités plus haut, bien connus des pèlerins, sont éminemment phénoménologiques en ce qu'ils indiquent le lien essentiel de co-naissance entre l'homme et le monde. Ils indiquent aussi un mouvement de réappropriation au cœur duquel en vient progressivement à dominer le sentiment du sacré. En ce sens, j’oppose le corps marchan-t au corps marchan-d, toujours plus ou moins aliéné, pris dans les reîtres de l’identité et de la productivité économique : la marche participe en effet d’un ré-enchantement du monde, avec ses lieux singuliers et leur histoire. Un peu comme l’œuvre d'art de l'âge classique, le paysage du marcheur conserve son aura ; contrairement à l’œuvre d'art de l'ère de la reproduction technique qui ressemble à certains égards aux abords des villes actuelles - tous identiques, avec leurs périphéries, leurs ronds-points et leurs centres commerciaux.
Comme le poète ou le peintre à ses heures inspirées - et je pense particulièrement à Cézanne -, tout se passe comme si le pèlerin s’extrayait d’un rapport utilitaire au monde environnant pour aller vers l’initial, un monde fait de signes, avant la saisie rationnelle et pratico-technique de cet univers. C'est cet "avant" que, dans l’expérience phénoménologique, Husserl appelle l’ante prédicatif, et qui correspond aussi à la recherche de Cézanne d'une peinture totale, géologique, avant même la venue des hommes et leur distinction en différents domaines sensoriels ("Il faut pouvoir peindre l'odeur des falaises de marbre de l montagne Sainte Victoire").
Dans un tel rapport, c'est d'abord le corps qui est sollicité ; c’est par lui, par la symphonie des sens pleinement éveillés (Ô sublimes aurores rougeoyantes du chemin !), tout autant que par ses douleurs, que j’ai le sentiment d’être partie prenante du cosmos, et plus loin, d’un réseau de significations oubliées, mais subitement régénérées. Les arbres, l’eau de la fontaine, les lapins, le renard, les serpents, les cigognes, mais aussi les hommes et femmes croisés sur le chemin, les paroles et les regards échangés, s’inscrivent alors dans un subtil réseau de sens.
.
Comme l’ont bien vu nombre de philosophes - de Aristote à Nietzsche, en passant par Rousseau, Kant et bien d'autres -, la marche est propice à l’émergence de la pensée, à une incorporation, une lente et féconde rumination (pour reprendre l'expression de Nietzsche) qui permet aussi bien de forger des idées que d’en abandonner certaines autres.
La marche au long cours contribue à nous alléger des contraintes du moi et à nous ancrer tranquillement et progressivement dans une présence à soi. Comme dans le Tao, la randonnée entraîne une sorte de cessation ou de retrait de l'activité subjective - dépassement des limites du moi qui est source d'ouverture et de régénération. Quand elle a lieu sur un temps assez long et sur un rythme régulier, la randonnée transforme la problématique de l’ici et maintenant en celle, plus délicate, de la sensibilité à la durée, au moment qui passe. Durée qui est diffusion/infusion lente, silencieuse, à peine perceptible, de la présence, éveil sensoriel, primaire et animal. Petit à petit, le marcheur est renvoyé vers ce qui est finalement élémentaire, dans une rencontre nuptiale avec la nature, et, plus loin, en vertu de ce recentrage, avec ce qui fait notre commune humanité.
.
.
Le livre de Frédéric Gros, Marcher, une philosophie, montre bien les liens entre marche et pensée. En ce qui me concerne, j’ai particulièrement apprécié le thème de la différence "d’habiter" entre le marcheur et l’homme du commun : dans la vie commune, le passage entre deux lieux (entre domicile et travail, par exemple) est un moment de transport inessentiel au regard de ces deux lieux (le départ et le but) ; pour le pèlerin, au contraire, le « chez soi » essentiel est le dehors, le paysage traversé ; alors que les gîtes d’étape constituent les moments inessentiels et transitoires en question. Idée qui correspond en outre parfaitement à l’esprit de Compostelle, pèlerinage se caractérisant de façon spécifique par l’intérêt porté au chemin (et non au but) - contrairement à ceux de Rome ou Jérusalem, par exemple.
Concernant plus généralement l’activité du marcheur, F. Gros illustre bien ce que j’appelle une phénoménologie du corps marchant quand il écrit :
"Quand on marche, rien ne bouge, ce n'est qu'imperceptiblement que les collines s'approchent, et que le paysage se transforme. On voit, en train ou en voiture, une montagne venir à nous. L'œil est rapide, vif, il croit avoir tout compris, tout saisi. En marchant, rien ne se déplace vraiment : c'est plutôt que la présence s'installe lentement dans le corps. En marchant, ce n'est pas tant qu'on se rapproche, c'est que les choses là-bas insistent toujours davantage dans notre corps"
.
Sur un plan plus existentiel, le Chemin, ou la randonnée au long cours, vaut comme mise en abyme, concentré métaphorique de notre vie, avec, à chaque étape, ses joies, ses souffrances, ses diverses modalités relationnelles. Le chemin est une école : les moments de marche solitaire où l’on apprend à mieux se connaître et à éprouver ses limites acquièrent une intensité inédite. Nous sommes en effet reconduits à des besoins simples et primitifs : marcher, le gîte, le climat, les capacités et soucis du corps, le ravitaillement (le pèlerin n’est pas un touriste, il ne visite pas, ne lit pas ; il marche). Nous apprenons aussi que la joie est indissociable de la souffrance, que "la division du travail" est impossible en la matière et qu'elle suppose une acceptation plénière de la vie dans toutes ses composantes : "Sin dolor, no hay gloria !"
Ces périples nous conduisent enfin à mieux accepter notre solitude, et cette autonomie joyeuse s'avère source de rencontres plus authentiques, dans la mesure où elle devient accueil de l'autre, minimisant ainsi le risque de transformer cet autre en objet visant à combler notre manque.
.
.
Le marcheur fait l'expérience des dimensions telluriques de sa pratique, laquelle pratique permet en effet aux ressources physiques enfouies ou oubliées de se manifester dans leur plénitude. Moments de liberté, d'expression de la puissance du corps, de joie de se sentir pleinement vivant.
En marchant, chaque nouvelle aube est attendue dans l’effervescence, comme source de rencontres et d’inconnu ; la marche est en ce sens bergsonienne : une manière de se rapprocher de la vie comme source intarissable d'éternelle nouveauté. On s’enchante d’une aurore qui, tel un premier matin du monde, infuse dans nos corps. Nous nous éveillons à l’unisson d’une nature, d'un paysage dont la présence s’installe lentement en nous.
C'est sans doute cette joie de la marche, et le sentiment de gratitude qu'elle procure, que David Lebreton exprime (Éloge des chemins et de la lenteur) quand il écrit :
.
« Baigné de cette hospitalité qui semble porter ses pas, le marcheur éprouve une reconnaissance infinie, il se sent à sa juste place à l’intérieur d’un monde dont il sent combien il le dépasse mais l’accueille. Sentiment plein d’exister rehaussé par l’autorité qui se dégage des lieux. Vivre possède enfin une évidence lumineuse. Les marcheurs sentent souvent cette royauté qui les incite à repartir ».